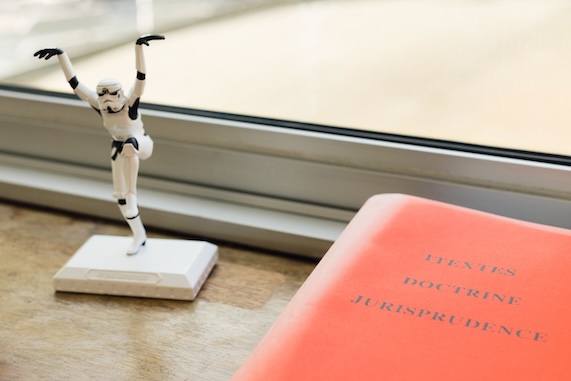Coup de théâtre à l’Assemblée nationale : les députés ont adopté un amendement anti-délocalisation conditionnant le bénéfice du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au maintien des activités de R&D en France.
Le Gouvernement et le Rapporteur général s’y sont opposés, alertant sur une mesure « contre-productive » susceptible de dissuader les groupes internationaux d’investir en France.
Malgré ces réserves, l’amendement a été adopté (93 voix pour, 63 contre) et introduit désormais une logique de sanction pour les entreprises qui, après avoir bénéficié du CIR, transféreraient leurs activités à l’étranger.
Une double peine en cas de délocalisation
Sans modifier le calcul du CIR, le texte introduit une clause de remboursement assortie d’une interdiction temporaire :
Remboursement intégral des crédits d’impôt perçus au titre des trois exercices précédents ;
Exclusion du dispositif pendant les trois années suivantes.
Autrement dit, l’entreprise qui délocalise sa R&D s’expose à un effet boomerang fiscal : non seulement elle perd l’avantage à venir, mais elle doit restituer les gains passés.
Le déclenchement de la sanction suppose deux conditions cumulatives :
- Une fermeture totale ou partielle d’un site de R&D en France ;
- Une réduction significative des effectifs sur le territoire.
L’objectif affiché est de cibler les délocalisations « économiquement et socialement dommageables », c’est-à-dire celles qui se traduisent par des suppressions d’emplois et un affaiblissement du tissu industriel français.
Une application rétroactive contestée
Plus surprenant encore : l’amendement prévoit une application rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
Concrètement, une entreprise ayant transféré une activité de R&D en 2024 ou début 2025 pourrait se voir contrainte de rembourser les CIR perçus sur 2021, 2022 et 2023.
Une telle rétroactivité, rarement admise en matière fiscale, risque de soulever de sérieuses difficultés constitutionnelles, notamment au regard du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois fiscales.
Deux visions de la politique industrielle s’affrontent
Cette adoption illustre la fracture entre deux approches :
La logique d’attractivité défendue par le Gouvernement : le CIR doit demeurer un levier pour capter les investissements internationaux et encourager la création de centres de R&D en France. Y ajouter des contraintes punitives reviendrait à saper cet avantage compétitif.
La logique de conditionnalité prônée par les auteurs de l’amendement : les 7 à 8 milliards d’euros d’argent public consacrés chaque année au CIR ne doivent pas financer des entreprises qui, in fine, suppriment des emplois français pour développer leur recherche à l’étranger.
Analyse critique : entre symbole politique et risque juridique
Ce texte traduit un malaise croissant autour de l’efficacité du CIR, régulièrement accusé de profiter davantage aux grands groupes qu’à l’écosystème d’innovation national. Mais en liant l’avantage fiscal à une obligation de maintien d’activité, le législateur transforme un incitatif en instrument punitif.
Outre les difficultés d’interprétation (quelle part d’activité constitue une « délocalisation » ? quelle temporalité de contrôle ?), le risque est double :
Un désintérêt des investisseurs étrangers, pour qui la stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal sont primordiales ;
Une avalanche contentieuse, notamment sur le terrain de la rétroactivité et de la proportionnalité des sanctions.
Notre lecture
Sous couvert de patriotisme économique, le dispositif risque d’affaiblir l’un des rares instruments fiscaux unanimement salués pour son impact sur la recherche. Le débat ne fait que commencer, mais le symbole est fort : l’ère des incitations inconditionnelles semble toucher à sa fin.
Affaire à suivre au fil de la navette parlementaire… et probablement, devant le Conseil constitutionnel.