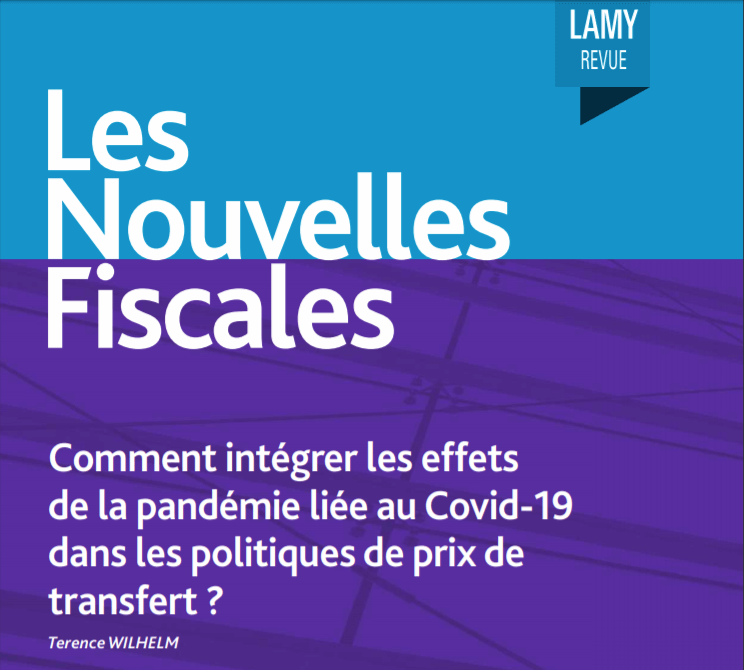(réponses pratiques aux questions remontées du terrain)
Il nous avait habitués à d’autres annonces. Le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE (CTP), qui il y a peu encore épiloguait sur « le nouveau droit d’imposition » lié à la mise en œuvre des piliers 1 et 2-1, concentre désormais ses efforts sur les moyens de soulager les contribuables dans l’actuelle crise sanitaire inédite liée à la pandémie du Covid-19 2 .
Car l’urgence est pressante et réelle. Lors d’une conférence de presse tenue le 2 mars dernier, le Chef économiste de l’Organisation, Laurence Boone, tentait par des formules mesurées de tempérer les statistiques alarmantes observées par les analystes 3 . C’est un fait : par-delà ses tristes conséquences sanitaires, la crise marque aussi par ses effets brutaux sur l’économie mondiale. En seulement quelques semaines, elle a provoqué un quasi-arrêt de toutes les activités marchandes, sur tous les continents. Et si certains secteurs économiques ont mieux résisté que d’autres, la plupart ont néanmoins vu leurs projections budgétaires voler en éclats et des pertes et manques à gagner sont enregistrés en tout ou partie des chaînes de valeurs.
Or, dans notre économie moderne, ces chaînes de valeurs sont fortement concentrées au sein de groupements d’entreprises. Les effets de cette crise vont donc en tout premier lieu affecter la matière des prix de transfert, qui régit les relations contractuelles et financières entre entités placées dans des relations de contrôle commun. Se pose alors la question de savoir comment attribuer ces effets entre les différents acteurs, avec comme composante sous-jacente l’identification (quels acteurs doivent nécessairement supporter ces effets) et la quantification (quelle proportion d’effets négatifs attribuer).
Certes, les effets concrets de cette situation inédite resteront à appréhender sur le long terme et avec le recul nécessaire, à la lumière des changements réglementaires qui suivront certainement ; des changements de paradigmes des autorités fiscales ; et des stratégies opérationnelles des acteurs économiques. Toute analyse actuelle doit donc faire preuve de prudence, autant que d’humilité.
Cependant et sans prétendre à l’exhaustivité, nous tâcherons dans les développements à suivre d’offrir des réponses aux questionnements qui taraudent les groupes d’entreprises et qui pour certaines nous ont d’ores et déjà été remontées du terrain. Pour ce faire nous suivrons un cheminement intellectuel logique, voire chronologique, en adressant l’attribution des pertes et en proposant quelques recommandations pour aménager les politiques de prix de transfert existantes.
Toutes les entreprises d’un groupe peuvent-elles accuser des pertes ?
La question de la gestion des pertes dans un environnement prix de transfert met en lumière une approche binaire et limitante, laquelle en réalité a souvent conduit au fil des ans à considérer que les pertes ne pouvaient être supportées que par une seule partie. Cette croyance ne saurait cependant résister à une analyse tant juridique qu’économique objective.
Rafraîchissons-nous la mémoire. Le principe de pleine concurrence développé par l’OCDE et repris par la quasi-totalité des Etats 4 incombe aux parties d’un même groupe d’entreprises de rémunérer les transactions qui les lient à la lumière des pratiques observables chez des parties tierces, indépendantes l’une de l’autre, et placées dans des situations comparables. Parce qu’il tend à se concentrer sur chaque transaction liée prise isolément, ce concept de pleine concurrence a cependant progressivement conduit à placer les entreprises liées dans une relation aveuglément binaire, réduite à un créancier et un débiteur, auxquels la pratique a substitué les termes « d’entrepreneur » et de « routinier ». Mais pour citer l’illustre professeur Nicolas Rontchevsky : « tous les praticiens se copient et se répètent, le problème est que le premier était un idiot ».
Car la vérité nous impose de reconnaître que ces terminologies sont vides de sens et sont d’ailleurs absentes des principes directeurs de l’OCDE, qui forment pourtant le socle de la fiscalité moderne des prix de transfert.
Ceci n’a pas empêché les praticiens, et l’administration fiscale en tête, de développer une approche manichéenne de l’économie moderne et de considérer que la partie à la transaction liée endossant le profil de routinier devait percevoir une rémunération fixe, à l’inverse de l’entrepreneur qui aurait par déduction droit aux profits ou pertes résiduelles. Bon an mal an, cette vision binaire a conduit dans de nombreux cas de figure à considérer que le routinier ne pouvait souffrir de pertes.
Une croyance limitante en générant une autre, on a en effet vu émerger un concept idoine, celui de distributeur ou fabricant routinier « à risque limité », qui n’est d’ailleurs guère plus décrit. Foi d’avocat fiscaliste, on a pu lire dans de très nombreuses propositions de rectification que ce distributeur ou fabricant « à risque limité », parce qu’il endosse un profil de routine, devrait percevoir « une rémunération faible, en adéquation avec ses fonctions et risques limités, mais nécessairement positive ».
Mais à quel moment de l’histoire de l’économie contemporaine a-t-il été considéré qu’un acteur économique serait prémuni contre le risque de perte ? Il s’agit là d’une interrogation à laquelle le fiscaliste s’est trop longtemps gardé de répondre, sans doute bien à l’abris derrière le principe de l’autonomie du droit fiscal (un autre concept dévoyé). Car en réalité, force est de reconnaître que n’importe quelle entreprise, indépendamment de son secteur d’activité, des fonctions qu’elle exerce ou des risques qu’elle porte (ce que les praticiens appellent « le profil fonctionnel ») peut à un moment de son histoire supporter des pertes, chroniques ou sporadiques.
En premier lieu, et sauf à ce que le contrat intragroupe n’en dispose autrement, la notion de « risque limité » ne devrait nullement signifier une immunité totale contre tout risque. Il s’agit là d’un trait commun à toute entreprise que de faire face à la volatilité de son marché, de même que de porter les conséquences potentiellement adverses de ses décisions. Qu’elle soit d’essence civile ou commerciale, une entreprise peut engager des dépenses qui vont excéder ses profits et ainsi, générer du déficit. Ceci demeure vrai même pour des structures dont l’objet n’est pas de réaliser des bénéfices, à l’instar des sociétés de moyens ou les groupements d’intérêt général. Pour ces derniers, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que, même placés dans une relation de dépendance, leur objet même justifiait l’absence de profit 5 . Pour autant, aucune réserve n’est formulée quant à l’impossibilité qui serait la leur d’enregistrer des pertes.
La génération de déficits peut même s’inscrire dans une stratégie économique, conforme à l’intérêt social d’une entreprise. Comme le relevait d’ailleurs le rapporteur public dans ses conclusions sous l’affaire précitée : « aucune disposition du Code général des impôts n’oblige une entreprise à faire des bénéfices 6» . Ceci conduit d’ailleurs à un second argument. En effet, force est de constater que rien dans le droit positif n’interdit de réaliser des pertes, dès lors que celles-ci ne reflètent pas un acte anormal de gestion. Il en est ainsi des stratégies de pénétration de marché ; d’investissements stratégiques à long terme ; ainsi que de ce que l’OCDE qualifie « d’approche de portefeuille » et que l’on retrouve dans les secteurs automobiles ou des biens de consommation, pour ne citer qu’eux 7 .
L’utilisation des pertes fiscales fait en outre l’objet de plusieurs articles du Code général des impôts. Rien que le troisième alinéa de l’article 209-I décrit avec une précision quasi mécaniquement le calcul du déficit reportable en avant. Dès lors que l’emploi des déficits est clairement et expressément décrit par la loi, sans réserver le régime à une catégorie spécifique de contribuables, comment pourrait-on considérer que certains, au motif qu’ils font partie d’un groupe, répondraient d’une autre logique ? Ceci conduirait à violer l’essence même du principe de pleine concurrence, en plus de rompre l’adage appris religieusement sur les bancs de la faculté de droit qui rappelle que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ».
Néanmoins, il est une autre loi qui pourrait s’imposer au cas d’espèce, à savoir « la loi entre les parties ». Ce concept, qui émane directement du principe de force obligatoire des contrats, découle de l’article 1103 de notre Code civil. Il suppose que dès lors que le contrat est équilibré et relève d’un consentement libre et éclairé (ce qui est de fait, une présomption entre entreprises), les parties à cet accord s’engagent à en respecter les termes. Indépendamment de la spécificité de la matière fiscale ou de l’environnement économique, ce principe s’impose comme un point cardinal dans notre système juridique qui, rappelons, est de droit écrit. Il est donc impératif, avant tout ajustement ou modification de la politique de prix de transfert, de revoir les contrats afin de déterminer la répartition des obligations de chaque partie à la transaction.
Ceci mis à part, la question pourrait légitimement se poser au sujet des commissionnaires réalisant des pertes. Bien que d’essence commerciale (le statut de commissionnaire découle de l’article L132-1 du Code de commerce), le commissionnaire tombe en effet de plein droit dans le chapitre du Code civil dédié au mandataire. Là encore, ce statut est clairement défini et encadré par le Code civil, et plus particulièrement les articles 1984 et suivants, que le juge commercial a contribué à enrichir au fil des ans. Un courant prétorien avait ainsi été amorcé par la Cour de cassation au profit des pompistes exploitant une concession de marque. Le juge suprême a considéré que les contrats les liant aux groupements pétroliers doivent nécessairement englober les pertes essuyées à l’occasion de la gestion 8 . Il a enfin précisé que l’article 2000 du Code civil s’opposait à ce que les parties mettent conventionnellement à la charge du mandataire les pertes qui ont pour origine un fait imputable au mandant 9 .
Le syllogisme devient dès lors tentant : considérant qu’un mandataire ne peut juridiquement et contractuellement accuser de pertes dans l’exercice de sa mission ; et qu’un commissionnaire est par nature investi d’un mandat de vente ; ce dernier devrait-il être obligatoirement prémuni contre tout risque de clôturer déficitaire ?
Il s’agit là à notre sens d’un juridisme un peu court. Si le commissionnaire doit percevoir une rémunération lui permettant de couvrir ses coûts, la loi ne lui octroie pas la capacité de dépenser sans compter. Les dépenses qui relèveraient donc de ses propres décisions doivent lui incomber. Là encore, il est essentiel de revoir le contrat le liant avec le donneur d’ordre et de s’assurer que celui-ci prévoit certains garde-fous. Enfin, nous sommes d’avis que le mandat donné au commissionnaire ne vaut pas pour l’intégralité des activités exercées communément au cours de l’exercice, mais pour chaque opération de vente. Dès lors qu’une vente est formée, alors le commissionnaire doit percevoir une rémunération adéquate. Si la demande s’effondre et qu’aucune vente n’est réalisée, alors on pourrait considérer que le commissionnaire n’est pas fondé à réclamer sa commission. En cas de baisse significative des ventes affectant toute la chaîne de valeur, ceci pourrait ainsi justifier des pertes dans le chef du commissionnaire.
Comment allouer les pertes entre les parties à une transaction intragroupe ?
La démarche la plus logique serait de répartir celles-ci au prorata de l’apport de chaque partie dans la chaîne de valeur totale. En pratique, cela revient à mettre en œuvre la méthode dite « du partage des bénéfices » (qui s’applique corrélativement aussi aux pertes) décrite par l’OCDE 10 .
Cette méthode, qui fut longtemps réservée aux transactions au titre desquelles les parties apportent des contributions uniques et de grande valeur (des biens incorporels uniques par exemple), retrouve une nouvelle vigueur sous l’impulsion des travaux BEPS. L’Organisation milite en effet pour un recours accru à cette démarche, en raison des faiblesses connues des méthodes traditionnelles, ou de la « méthode transactionnelle de la marge nette », qui demeure la plus répandue. On la retrouve d’ailleurs au premier plan dans les récents travaux sur le Pilier 1 et l’approche unifiée conduisant à terme à de nouveaux droits d’imposition des Etats.
Cependant, force est de constater que la méthode du partage des bénéfices est complexe à mettre en œuvre et requiert l’emploi d’agrégats comptables et économiques délicats à récupérer dans des groupements multinationaux. Pour l’heure, l’expérience montre que les autorités administratives manquent encore de maturité dans l’utilisation de cette méthode et tendent ainsi à l’écarter au profit des formules plus classiques, à l’instar de la méthode transactionnelle de la marge nette.
Exit donc le partage des bénéfices. Pour tester la nature de pleine concurrence d’une transaction, il nous paraît plus propice et plus simple de calculer une rémunération théorique, telle que tirée de l’activité si celle-ci avait été conduite à une période normale. Dans les faits, ceci revient à octroyer une profitabilité assise sur une base appropriée (les coûts supportés ou les ventes réalisées) et définies théoriquement à partir d’agrégats connus, anticipés et déconnectés de tout évènement extraordinaire comme l’actuelle crise qui sévit. Les budgets, dès lors qu’ils sont élaborés de concert entre les deux parties à la transaction peuvent servir de référence adéquate. Leur fiabilité sera d’autant plus grande si par le passé, il peut être démontré que les variations entre les projections issues des budgets et les données réelles comptabilisées à la clôture de l’exercice était faibles. Eventuellement, ce décalage pourra même servir de variable d’ajustement dans la mise en œuvre de notre méthode théorique.
En cela, cette démarche rejoint celle précédemment validée par le juge de l’impôt dans l’affaire Unilever 11 . Au cas d’espèce, la société fabriquait de la margarine sous la marque Astra et la revendait à une société belge appartenant au même groupe. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration avait remis en cause les prix consentis à la vente au motif que la marge de la société était devenue structurellement déficitaire. Non seulement son résultat d’exploitation (qui tient souvent lieu de référence pour l’administration) était négatif, mais sa marge brute l’était tout autant, dans la mesure où la société ne parvenait pas à couvrir ses coûts de fabrication. La société arguait que cette situation provenait de l’obsolescence des unités de production, ce qui, ramené à un autre environnement, correspond à une situation où le site ne fonctionne pas dans des circonstances normales et stables.
La Cour a écarté les velléités de l’administration, rejoignant en ce sens les préconisations de son Commissaire du gouvernement. Celui-ci considère avec une sagesse toute économique « qu’un fabricant a intérêt à vendre à perte pour couvrir ses frais variables et une partie de ses frais fixes, en d’autres mots, pour survivre ». Dans ses conclusions, il liste en outre les cas au titre desquels facturer à perte est parfois le seul moyen pour une entreprise de vendre au prix du marché. Le dernier cas correspond à une entreprise en difficulté, en raison de la conjoncture. Alors vendre à perte pour vendre au prix du marché, peut être le moyen de continuer l’exploitation en couvrant une partie des frais fixes, le temps nécessaire pour investir, voire se reconvertir. De surcroît et toute considération commerciale mise à part, on rappellera en outre que le juge de l’impôt n’écarte pas par principe l’avantage que procure une facturation anormale entre entreprises liées entre elles, si elle est le seul moyen de maintenir l’emploi sur un site 12 .
Pour apprécier avec un regard neuf l’anormalité éventuelle liée aux transactions intragroupes, la Cour préconisait alors de reconstituer les marges si la ligne de production d’Astra fonctionnait selon des standards normaux, c’est-à-dire débarrassés des circonstances extraordinaires qui obéraient ses marges. Dans cet environnement, il nous paraît donc tout aussi concevable de recalculer les comptes de résultats de la société en la replaçant dans une situation stable et pérenne, par exemple, en prenant en compte les budgets réalisés avant la crise. Les coûts non anticipés, qui découlent donc des effets de la crise, ne seront pas pris en considération, alors même qu’ils vont obérer la marge nette totale de la société.
Quels comparables utiliser pour tester la nature de pleine concurrence des transactions ?
On l’a vu précédemment, il devrait être non seulement permis, mais parfaitement défendable d’accuser des pertes au titre de transactions intragroupes, même si initialement la politique de prix de transfert pouvait prévoir une marge à octroyer à la société. Cette démarche connaît néanmoins une limite, celle de refléter des conditions de marché. Il faut donc pouvoir démontrer que placés dans une même situation, des sociétés indépendantes et comparables ne feraient guère mieux. Ceci renvoie donc à la problématique de trouver des comparables fiables permettant d’asseoir notre argumentation.
Il est évident que les comparables disponibles actuellement sur les bases de données n’intègrent pas les effets économiques de la pandémie de Covid-19. A l’heure où nous couchons ces lignes sur le papier, les données les plus récentes concernent les exercices clos au 31 mars 2019, soit un an en arrière. A l’époque, personne n’imaginait ce que traverserait le monde et votre serviteur ignorait ce qu’est un pangolin. Il est donc nécessaire d’ajuster artificiellement les comparables auxquels il est possible d’avoir accès. De tels ajustements sont qui plus est permis et recommandés par l’OCDE, pour justement neutraliser les différences observables dans les facteurs de comparabilité, au titre desquels figurent les circonstances économiques.
Une première solution pourrait alors consister à appliquer la baisse observable en pourcentages sur un secteur ou un pays donné et issue des statistiques tenues par l’INSEE, l’OCDE, ou d’autres organismes professionnels, sur les marges des comparables.
Une méthode alternative, ou corroborative, pourrait consister à calculer la rentabilité d’une activité sur les mois de l’exercice qui n’avaient pas encore été touchés par la crise. Ce faisant, il serait possible de renvoyer une image réelle, observée sur une période normale. Ces données seraient ensuite comparées aux références les plus récentes issues de bases de données. En cas d’adéquation, il serait dès lors permis de conclure que, hors cas exceptionnels tels que l’actuelle crise, la politique de prix de transfert conduite jusqu’alors reflétait un état de pleine concurrence. Cependant, cette démarche ne fonctionne que pour les sociétés ne clôturant pas au 31 décembre et pour lesquelles une plage de mois suffisamment représentative est disponible.
Une troisième piste pourrait enfin consister à rechercher le comportement des comparables retenus pour tester précédemment la politique de prix de transfert, au cours de périodes de crise. Par exemple, dès lors qu’un panel de comparables a été utilisé en 2019, il serait intéressant de regarder la variation des marges de ces mêmes comparables lors des crises financières de 2008 et 2010. Bien évidemment, malgré leur violence à l’époque, force est d’admettre que ces crises étaient sans commune mesure avec celle que nous connaissons aujourd’hui. Mais cette démarche aura au moins pour effet de démontrer que des sociétés indépendantes, réputées comparables, peuvent aussi voir leurs résultats chahutés lors de périodes troubles. Ceci permettra encore une fois d’arguer aux yeux de l’administration que des entreprises endossant un profil similaire, même « limité », peuvent souffrir économiquement sans être prémunies contre les pertes.
Est-il possible de suspendre ou modifier les contrats intragroupes ?
La matière des prix de transfert est certes fortement empreinte de théories économiques, elle n’échappe pas pour autant aux conceptions juridiques les plus élémentaires, à commencer par la force obligatoire des contrats. Avant toute action, il est donc impératif de revoir avec un œil critique le contenu des conventions intragroupes afin de s’assurer des conditions permettant éventuellement de suspendre, résoudre ou modifier les conditions de l’exécution d’un contrat.
Une première tentation pourrait consister à invoquer la force majeure. Rappelons-le, constitue un cas de force majeure, un évènement indépendant de la volonté du débiteur, irrésistible et imprévisible au moment de la conclusion du contrat 13 . Son intérêt est qu’elle entraine une exonération temporaire ou définitive de l’exécution des obligations et la résolution du contrat, selon le cas, ce qui dans le cas présent pourrait permettre aux parties liées de déroger aux politiques de prix de transfert.
De fait, la force majeure n’a jamais été reconnue jusqu’alors s’agissant d’évènements de pandémie puisqu’ils n’ont pas, jusqu’à aujourd’hui et fort heureusement, suffisamment affectés les activités des acteurs économiques. Il pourrait en être différemment s’agissant du Covid-19, tant on peut déjà noter certaines décisions prises par les juridictions, mais dans des cas particuliers de la rétention administrative ou de mesures administratives d’éloignement d’un étranger. Dans ces cas spécifiques, les juges ont considéré que l’impossibilité d’agir résultant de la pandémie constituait bien un cas de force majeure, notamment en raison de la fermeture des frontières. A ces exemples éloignés, on serait également tenté d’ajouter la référence à la position générale prise par Bruno Lemaire en matière de marchés publics, selon laquelle l’Etat va considérer le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises.
En tout état de cause, il est essentiel de vérifier les termes des clauses relatives à la force majeure dans les contrats et les conditions générales éventuellement applicables, ainsi que la procédure à respecter, le cas échéant. En effet, les règles prévues contractuellement pourraient être plus souples que celles du droit commun, qui ne sont que supplétives. Il n’en demeure pas moins qu’il sera plus difficile de retenir un paiement sur le fondement de la force majeure, les juges considérant que celui-ci n’est pas fondamentalement empêché.
Aussi, dans certaines situations, il pourrait être davantage opportun d’examiner si l’imprévision peut être plus utilement invoquée que la force majeure. En effet, ne constituent pas des cas de force majeure les circonstances difficiles qui ont rendu particulièrement onéreux mais pas impossible l’exécution de l’obligation. Dans ce cas, peut être envisagée la renégociation du contrat, ce qui entre parties liées, s’avère logiquement plus aisé. Dans ce cadre, les parties pourraient légitimement apporter quelques aménagements temporaires à la politique de prix de transfert et notamment, transgresser la méthodologie de rémunération, tout en prévoyant une répartition adéquate et juste des pertes.
Quel impact produisent les dispositions réglementaires exceptionnelles sur les politiques de prix de transfert ?
Pour accompagner leurs contribuables dans cette tourmente, la très grande majorité des Etats a adopté dans l’urgence des mesures exceptionnelles, certaines visant à réduire la charge fiscale, ou d’autres, à l’instar de la France, préférant le report ou l’aménagement calendaire. Certaines corporations ont même obtenu des aides temporaires, prenant la forme de subventions, de remises gracieuses ou de libéralités (notamment des prêts à taux zéro). Mais dès lors qu’elles influent sur le résultat de la société, se pose alors la question du traitement de ces mesures du point de vue du calcul de la méthode prix de transfert. La plupart des méthodes en effet vise à attribuer une marge fixe à la partie testée. Doit-on alors intégrer ces subventions dans le calcul de cette marge ?
En substrat, cette question renvoie irrémédiablement à la décision Philips du Conseil d’Etat 14 . Il était alors question de savoir si, aux fins de calculer la marge nette sur la base de coûts totaux que la société Philips refacturait à sa mère, celle-ci était en droit de déduire le crédit d’impôt recherche dont elle bénéficiait de la base de coûts sujette à refacturation. Fort logiquement, l’administration répondait par la négative, en arguant que les subventions reçues avaient la nature de subventions d’investissement et demeuraient donc étrangères aux dépenses d’exploitation, qui forment la base de la méthode prix de transfert retenue par le groupe. Le juge de cassation a cependant annihilé les prétentions du service, confirmant en cela la décision d’appel, au motif que l’administration n’avait pas démontré que des entreprises indépendantes, placées dans des conditions comparables, n’auraient pas déduit le montant du CIR de leur base de calcul.
Si cet arrêt ne tranche malheureusement pas la question de fond (comment prendre en compte les subventions dans le calcul de la méthode de prix de transfert), elle a le mérite de renvoyer au comportement « normal » des parties sur le marché libre. A ce titre, il est peu probable qu’en période de crise, où chaque acteur de la chaîne de valeurs est affecté, une partie à une transaction fasse supporter à l’autre le poids du cadeau pourtant offert par un autre, l’Etat en l’occurrence. En d’autres termes, les éventuels avantages exceptionnels reçus ne devraient pas venir s’ajouter à la base de coûts sujette à la méthode du prix de revient, ni en sens inverse, venir diminuer l’assiette retenue au titre de la méthode du prix de revente. Qui plus est, pour apporter la preuve d’une anormalité liée à la non prise en compte de ces subventions, il faudrait encore pour l’administration réussir à produire des références comparables fiables, ce qui, en l’état des bases de données actuelles, relève d’une mission impossible.
Reste qu’une décision plus récente pourrait jeter le trouble sur notre position. Dans son arrêt Laps France 15 en effet, le juge du fond avait considéré que le contribuable devait refacturer la CVAE au même titre que ses autres coûts d’exploitation à sa partie liée, dès lors que la méthode adoptée par le groupe enjoignait de refacturer la totalité des coûts d’exploitation. La CVAE ayant été comptabilisée dans un compte de charges de gestion courante (et non d’impôts), elle tombait mécaniquement dans l’assiette sur laquelle la marge nette s’appliquait. Il nous semble cependant que ce raisonnement souffre de plusieurs failles, en plus de renvoyer à une problématique sensiblement différente de celle analysée dans ces lignes.
En effet, dans cette affaire, il était question de refacturer une charge venant grever le profit de l’entreprise, et non une subvention reçue. Si les avantages perçus devaient être refacturés, la société en bénéficierait mécaniquement deux fois, en plus comme on l’a vu de condamner un peu plus ses partenaires économiques. En outre, une analyse de comparabilité sur des bases de données, ajustée comme nous l’avons suggéré plus haut, produirait à n’en pas douter des marges largement amputées, là où celle de notre comparables serait nécessairement augmentée.
En définitive, les avantages, subventions et autres libéralités perçus devraient être considérés comme des produits exceptionnels et partant, échapper au calcul de toute méthode de prix de transfert.
1 Le 31 mars 2019, le Cadre Inclusif de l’OCDE et du G20 sur le BEPS a publié son « Programme de travail pour développer une solution de consensus répondant aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie ». Ce document, adopté par les 129 membres du Cadre Inclusif, a été approuvé par les ministres des finances du G20 les 8 et 9 juin 2019.
2 Voir sur ce sujet « OECD, FORUM ON TAX ADMINISTRATION, Tax Administration Responses to COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers, 26 March 2020 », disponible sur le site de l’OCDE.
3 OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, Rapport intermédiaire Coronavirus : l’économie mondiale menace, 2 mars 2020, disponible sur le site http://www.oecd.org/perspectives-economiques/
4 En France, l’article 57 qui constitue la pierre angulaire de notre réglementation des prix de transfert a depuis longtemps été reconnu compatible avec l’article 9 du modèle de convention de l’OCDE qui intègre le principe de pleine concurrence. Voir par exemple CE, arrêt du 14 mars 1984, n° 34430 et n° 36880.
5 Voir en ce sens CE 25 nov. 2009, 3ème et 8ème ss sect. réunies, n°307227, Cie Rhénane de Raffinage.
6 Conclusions M. Geffray sous CE 25 nov. 2009, 3ème et 8ème ss sect. réunies, n°307227 au BDCF 2010 2/10 n° 106.
7 Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, juillet 2017, §3.10.
8 Cass com 17 déc. 1991, n° 89-20688 ; 90-11661.
9 Cass com 26 oct. 1999, n° 96-20063.
10 Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, §2.114 et suivants.
11 CAA Versailles, 6ème ch. 5 déc. 2011, n° 10VE02491.
12 Par exemple CAA Nancy 6 mars 1996 société Nord éclair n° 94-1326 n°1464.
13 Article 1218 du code civil.
14 CE 19 sept. 2018, n°405779, Sté Philips SAS.
15 TA Montreuil, 9ème ch. 14 février 2019, n°1801945.