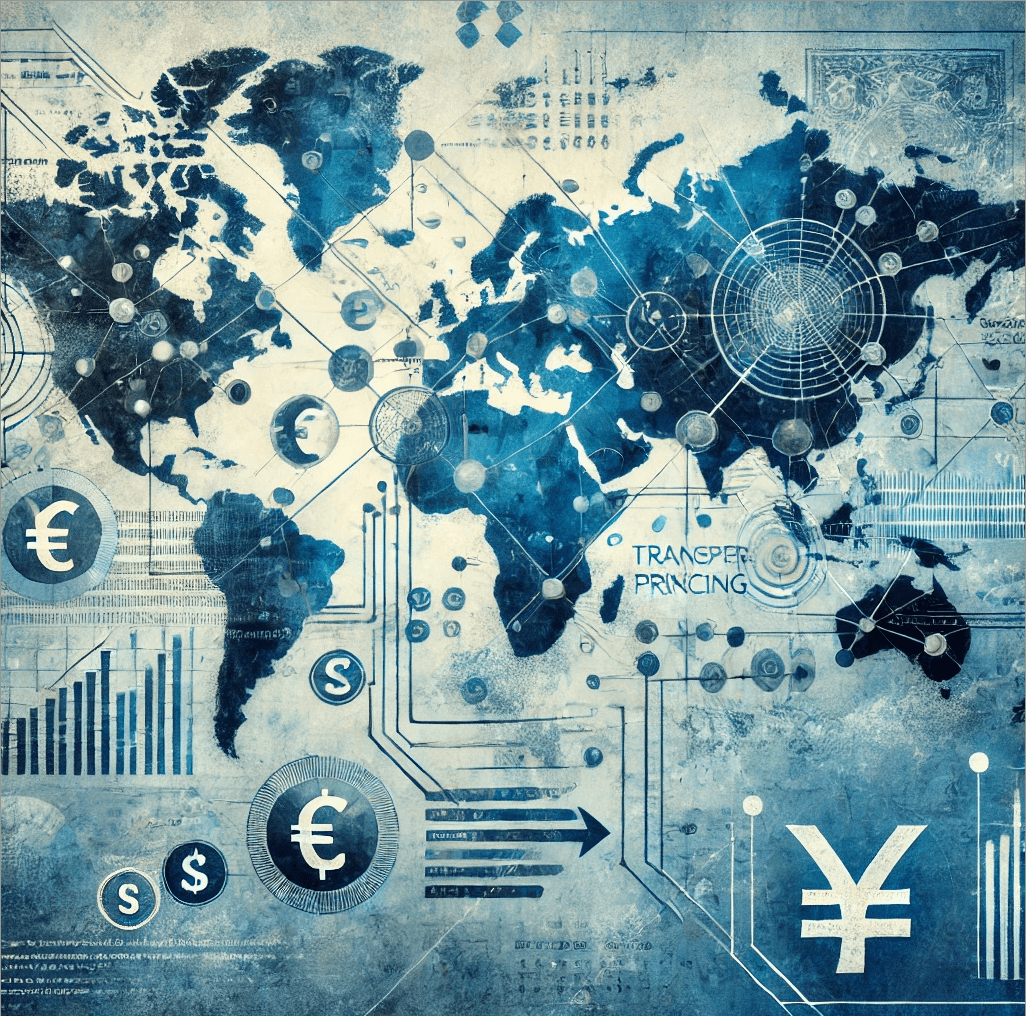CAA Lyon, 5ème ch. 21/12/2023; n°21LY02821; Sumitomo
Chemicals Europe
LES FAITS
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Sumitomo Chemicals Europe (SCAE), l’administration fiscale a considéré que les transactions intragroupes dans lesquelles celle-ci était impliquée ne respectaient pas le principe de pleine concurrence. Les avantages ainsi concédés ont été classiquement qualifié de « revenus réputés distribués », ce qui compte tenu des conventions fiscales applicables, donnent lieu à une retenue à la source. Dans la mesure où la société n’a évidemment pas déclaré cette retenue à la source, dont l’existence n’a été mise en lumière qu’à l’issue de la rectification, la pénalité de l’article 1728 du CGI.
LA RÈGLE
Pour rappel, dès lors qu’une rectification sur le terrain de l’article 57 du CGI est opérée par le service, celui-ci considère qu’un transfert indirect de bénéfice a eu lieu, qui doit alors suivre le traitement des distributions de dividendes. Une retenue à la source est alors prélevée, en plus de l’impôt sur les sociétés, et dont le taux est calculé par référence à la convention fiscale applicable au cas d’espèce. Il s’agit là d’une conséquence collatérale des rectifications en matière de prix de transfert, qui a à de nombreuses reprises été validée par le juge de l’impôt et que nous ne discuterons pas ici.
La pénalité visée à l’article 1728 du CGI sanctionne le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette pénalité, exprimée en pourcentage du montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, est égale à 10% en l’absence de mise en demeure, ce qui est le cas à l’issue d’une rectification mettant en lumière un revenu réputé distribué.
LA POSITION DES JUGES
Le TAA de Lyon en 2021, avançait dans son considérant numéro 20 « En se bornant à faire état du caractère non volontaire de cette omission et de son droit à l’erreur, la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des pénalités ainsi mises à sa charge sur le fondement des dispositions précitées ». Or, dans de nombreux cas, il ne s’agit pas pour le contribuable de faire état de sa bonne foi ou de son droit à l’erreur, ni de requérir la modération de ces pénalités, que le juge de l’impôt s’est toujours refusé à pratiquer. Il s’agit au contraire de la pertinence d’une pénalité automatique, liée à une infraction dont le contribuable ne peut connaître l’existence ni le quantum avant les rectifications.
La CAA persiste toutefois, et considère que « les dispositions précitées proportionnent la majoration aux agissements commis par le contribuable en prévoyant que son montant est fixé en pourcentage des droits éludés. Il ressort en outre des dispositions de l’article 1728 que les taux de majoration appliqués varient selon que le défaut de déclaration dans le délai a été constaté sans mise en demeure de l’intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses, de sorte que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère automatique de l’application d’une majoration de 10 % ne peut qu’être écarté ».
NOTRE ANALYSE
UNE PÉNALITÉ IMPOSSIBLE À PRÉVOIR DANS SON PRINCIPE…
Dans la mesure où la pénalité de l’article 1728 du CGI est appliquée de manière automatique, dans une situation où le contribuable est dans l’impossibilité de s’y conformer, elle excède selon nous l’objectif que cet article est censé poursuivre et crée donc une erreur dans l’appréciation de la base légale.
Il nous semble en effet que le bienfondé fiscal d’une pénalité automatique est à revoir, dès lors qu’elle vient sanctionner un comportement non seulement involontaire du contribuable, mais surtout inévitable, tant le contribuable ne peut avoir connaissance ni de l’existence, ni du montant de la retenue à la source à déclarer.
En effet, cette pénalité vient frapper la retenue à la source, qui elle-même est une conséquence collatérale d’une rectification principale en matière d’impôt sur les sociétés, et dont l’existence et le quantum ne sont connus qu’à l’issue de la
procédure de contrôle:
Sur l’aspect temporel d’une part : cette retenue à la source découlant du transfert indirect de bénéfice ne peut en toute logique être connue du contribuable qu’à l’issue du contrôle fiscal, soit après que l’administration a considéré qu’un transfert indirect de bénéfice a eu lieu. Il est donc matériellement impossible que le contribuable puisse produire la retenue à la source dans les temps qui lui sont impartis, puisque le fait générateur de cette retenue lui est alors inconnu. Au cas d’espèce, l’administration a mis en lumière l’existence de la retenue à la source à l’occasion de sa proposition de rectification du 4 août 2014, soit pour l’exercice 2010, 44 mois après le fait générateur réputé ; et 32 mois après le fait générateur pour l’exercice 2011. Or, pour se conformer à l’article 1728 du CGI, le contribuable aurait dû théoriquement déclarer le transfert de bénéfice avant le quinzième jour qui suit le mois de ce transfert, c’est-à-dire avant le 15 janvier 2011 pour l’exercice 2010 ; et avant le 15 janvier 2012 pour l’exercice 2011.
NI DANS SON QUANTUM!
Sur le quantum, d’autre part : la pénalité est exprimée en pourcentage de la retenue à la source, elle-même étant calculée par référence aux rectifications en matière de prix de transfert.
Plus exactement, cette retenue à la source vient frapper le rehaussement en base opéré sous le visa de l’article 57 du CGI, qui est alors qualifié de revenu réputé distribué. Or, la matière des prix de transfert forme une discipline subjective, dont les bornes ne sont pas clairement tracées. Qu’il s’agisse des transactions tombant dans le champ de cette matière, ou de l’étalonnage du transfert réputé de bénéfice, le contribuable ne peut rationnellement et à l’avance connaître avec exactitude le montant d’un transfert indirect de bénéfice et, partant, le montant de retenue à la source théorique qu’il aurait dû déclarer.
LES BENCHMARKS POUR TOUS?
Enfin, nous rappellerons que les pénalités fiscales, qui sont synonymes de sanctions, visent à réprimer le comportement du contribuable. C’est là l’essence même de la différence avec l’intérêt de retard, qui entend pour sa part compenser le préjudice financier. La jurisprudence du Conseil d’Etat est claire sur ce point, et souligne a contrario le lien intrinsèque entre les pénalités fiscales et le comportement du contribuable. Or dans notre cas, le comportement du contribuable ne peut en aucun cas être volontaire, pas plus qu’il peut être au cas d’espèce modifiable, ou anticipé. En cela, nous pensons que l’article 1728 du CGI ne peut trouver application en pareil cas, car son dispositif devrait être limité aux cas où le contribuable a connaissance des obligations qui pèsent sur lui.
Maintenir alors les sanctions de l’article 1728 reviendrait à retirer leur qualité de pénalités fiscales, pour en faire de véritables impôts. En effet, ces pénalités seraient alors dissociées du comportement, qui constitue l’élément intrinsèque pour tomber dans le champ des pénalités fiscales, mais viendraient en réalité appliquer automatiquement un taux (en l’espèce 10%) sur une assiette (le transfert réputé de bénéfice), à l’instar d’un impôt.