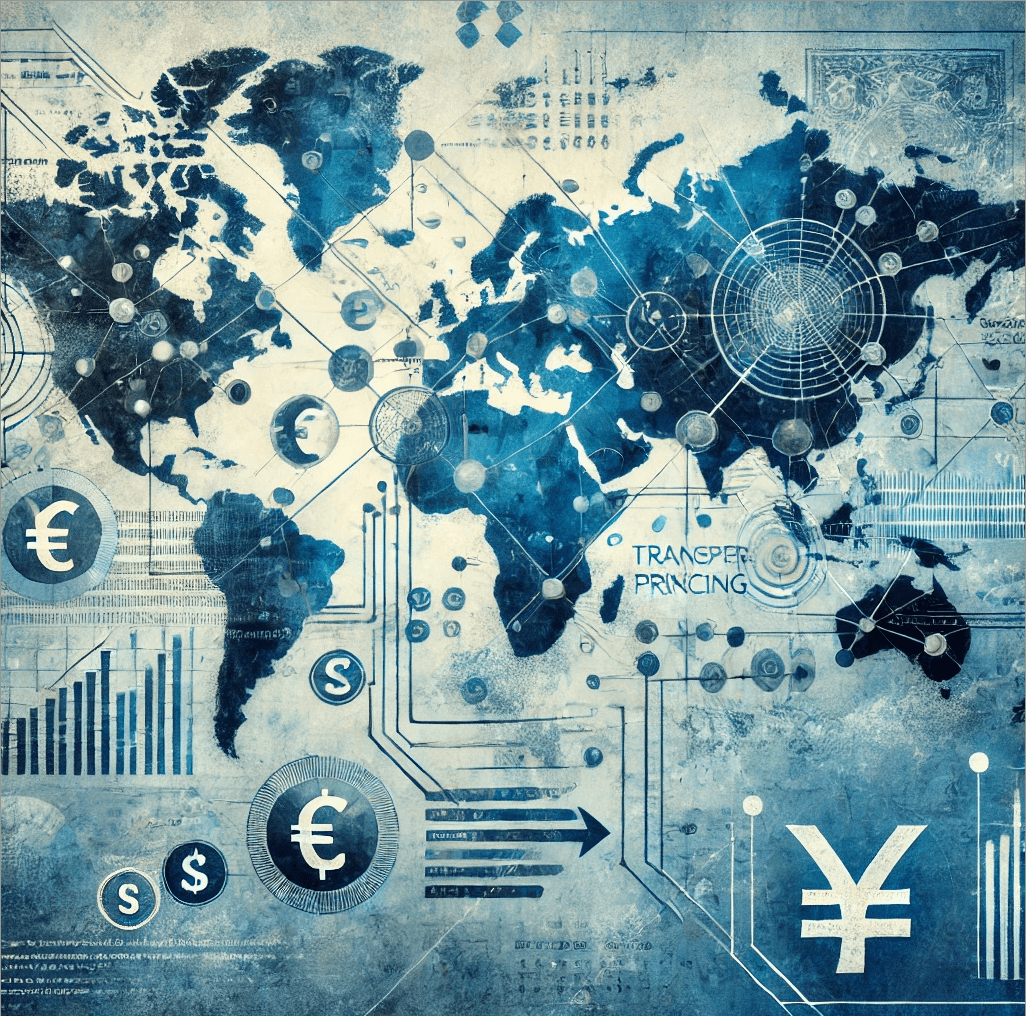Ces dernières années, l’article 39-1-3 du code général des impôts a réussi à se hisser parmi les dispositifs fiscaux les plus connus. Comme une sorte de code, un mot de passe numérique réservé à une communauté à part. On ne parle plus du taux d’intérêt déductible. On dit « le taux du 39-1-3 ». Faites le test, cela vous permettra de repérer les fiscalistes dans l’assistance.
Pour rappel ce texte, aussi incongru et anti-économique soit-il, précise que « les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, [sont déductibles] dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ».
Incongru, car il se pose comme une spécificité française dont Bercy a le secret, et s’ajoute à une liste déjà longue de dispositifs visant à contraindre les charges financières des entreprises.
Anti-économique, car il conduit les entreprises à devoir limiter la déductibilité fiscale d’intérêts qu’elles servent à des associés minoritaires (voire très minoritaires), alors qu’une exception est offerte aux associés détenant plus de la majorité du capital social de la débitrice grâce à l’alternative visée à l’article 212-I. Cela peut donc conduire dans les faits à contraindre les entreprises ayant souscrit un emprunt, ou qui ont émis des obligations au profit d’établissements bancaires tiers, et qui comme souvent, entrent au capital de ladite société pour suivre son évolution. Voyez le paradoxe : la BPI, qui contribue à l’essor de notre économie, détient très souvent des parts minoritaires dans le capital des sociétés qu’elle soutient ; les mêmes sociétés qui ne pourront donc pas déduire l’intégralité des intérêts financiers qu’elles lui reversent, dès lors que les taux d’intérêt pratiqués à leur égard, quand elles sont en situation de démarrage, ou pour des obligations qu’elles émettent, sont statistiquement bien au-delà du taux du fameux article 39-1-3.
Mais dès lors que ces actionnaires minoritaires sont situés dans un autre Etat que la France, ce dispositif de l’article 39-1-3 du CGI résiste-t-il au principe de pleine concurrence, visé à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE ? Ce principe de pleine concurrence peut en effet offrir un taux radicalement distinct, dès lors qu’il reflète des conditions de marchés et ce que des entreprises indépendantes, placées dans une situation similaire, auraient négocié entre elles.
Si l’on se pose un instant, la limitation prévue par cet article 39-1-3 entre en effet en contradiction avec l’article 9 du modèle, que l’on retrouve dans toutes les conventions signées par la France, et qui permet d’appliquer un taux alternatif. Les principes de subsidiarité et de primauté des traités devraient alors jouer leur rôle cher aux théoriciens du droit fiscal, et donc faire prévaloir la possibilité des parties liées de démontrer la justesse du taux qu’elles ont appliqué en réalité.
Dans bon nombre de conventions, l’article 9§1 vise le cas d’une « entreprise d’un Etat contractant [qui] participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant ». Or, participer directement ou indirectement à la direction ou au capital ne requière pas d’être associé majoritaire. Si l’on s’en tient là, le principe de pleine concurrence pourrait donc être appliqué à tout associé dès lors que par nature, celui-ci « participe au capital ». Mais comme tout bon fiscaliste est un paranoïaque en puissance, allons plus loin et posons-nous un instant sur la notion de « contrôle », qui semble plus ambigüe. Or, force est de constater que la définition de cette notion telle que produite par l’OCDE semble aussi grise que le béton du château de la Muette qui abrite ses services.
Les commentaires de l’OCDE indiquent en effet que « Deux entreprises sont associées si l’une d’entre elles remplit les conditions fixées à l’article 9 alinéas 1a) ou 1b) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE vis-à-vis de l’autre entreprise ».
Les commentaires éclairant l’article 9 du modèle de convention précisent quant à eux que « le comité a consacré beaucoup de temps et d’efforts (et continue de le faire) à l’étude des conditions d’application de cet article, aux conséquences de cette application, et aux méthodologies qui sont applicables pour l’ajustement des bénéfices lorsque des transactions ont été conclues dans des conditions autres que celles de pleine concurrence. Les conclusions de cette étude sont décrites dans le rapport intitulé ‘principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales’ qui est périodiquement mis à jour dans le but de tenir compte de l’évolution des travaux du comité sur cette question. Ce rapport représente des principes internationalement admis et donne des lignes directrices pour appliquer le principe de pleine concurrence dont l’article 9 constitue l’énoncé faisant autorité ».
Poursuivons donc le jeu de piste et référons-nous alors aux principes directeurs de l’OCDE qui…reproduisent la même définition que les commentaires sous la convention modèle.
Il apparait donc que la notion de contrôle, qui est clé pour l’applicabilité du principe de pleine concurrence, n’est pas explicitement ou formellement définie par les standards du droit international. La nature ayant horreur du vide, il convient alors de se reporter au droit interne de chaque Etat.
Dans notre cas, l’article 39-12 du CGI précise que « Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : (a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; (b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ». Du point de vue de notre droit positif français donc, le contrôle semble bien devoir être apprécié sous l’angle de la majorité (du capital ou du pouvoir de décision).
Le jeu de piste aurait-il alors conduit à une impasse, laissant le contribuable face à la froide injustice de l’article 39-1-3 ? Et bien, peut-être pas pour longtemps. La Commission européenne a dévoilé, le 12 septembre 2023, deux projets de Directives, relatives, respectivement, à l’initiative « BEFIT » et à une harmonisation des règles prix de transfert au sein de l’UE. Ce second projet de directive entend simplifier la réglementation applicable et de réduire le risque de double imposition, en intégrant le principe de pleine concurrence dans le droit de l’Union. Un des biais par lequel la sécurité fiscale serait renforcée passe par l’harmonisation des principales règles en matière de prix de transfert, en créant la possibilité pour la Commission d’établir, au sein de l’Union, des règles communes sur des sujets spécifiques.
Or, pour définir une entreprise associée, l’article 5 du projet de Directive propose notamment de retenir un seuil de détention de minimum 25% dans les droits de vote, le capital ou le bénéfice d’une entité pour établir un lien de dépendance. La transposition en l’état de la Directive conduirait donc mécaniquement et nécessairement à permettre aux associés minoritaires de se prévaloir du principe de pleine concurrence, et donc de faire échec aux dispositions de l’article 39-1-3 du CGI qui, en figeant un taux d’intérêt, vient en contradiction avec l’alternative offerte par le droit international et plus spécifiquement l’article 9 du modèle de convention fiscale. La contrainte du dispositif de l’article 39-1-3 du CGI dont souffre actuellement les associés minoritaires seraient donc levée pour certains associés seulement, qui d’une part disposeraient de 25% au moins du capital social, soit directement, soit indirectement, ou qui seraient placés sous une entité commune dépassant ce seuil ; et d’autre part, qui seraient résidents d’un autre Etat que la France.
Notre droit positif créerait cependant une double discrimination, en maintenant sous le joug de l’article 39-1-3 les associés ultra-minoritaires, détenant moins de 25% du capital de la société débitrice, et les associés établis en France. Pour ces derniers, la discrimination à rebours nous a déjà habitué à moins bien traiter les opérations purement domestiques.
Pour les associés étrangers, mais détenant moins de 25%, le fisc vous le dira : on a toujours besoin d’un plus petit que soi.